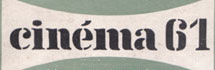Crée en avril 1951 à Paris par Doniol-Valcroze, Bazin et Lo Duca, ils « veulent soutenir des films " témoins fidèles des efforts les plus hauts et les plus valables du cinéma français "» Revue au centre des interrogations et des remises en question en ce qui concerne la critique. Elle a beaucoup contribué à mettre en place une nouvelle façon de voir les films, d’en parler, et par la suite de les classer. Les années 50 sont marquées par les jeunes turcs de la nouvelle-vague (Truffaut, Godard, Rivette…). Ils ont une ligne de conduite très polémique et n’hésitent pas à dénigrer un certain cinéma Français et défendre des films dits d’auteur. Plus l’attaque est franche et outrageuse, plus la répercussion est grande. Ils sont souvent à l’origine des articles qui ont marqué l’histoire de la critique ( par exemple, le n°31 en janvier 1954, « une certaine tendance du cinéma »). Critiquer devient une histoire de politique quand François Truffaut, en février 1955, met en place la politique des auteurs. Au début des années 60, ces jeunes délaissent petit à petit la rédaction pour s’investir sur le terrain en réalisant leurs premiers films. La nouvelle vague prend alors son essor et les cahiers se retrouvent en crise d’identité qui tient, selon De Baecque, à une indécision des choix et une division de la rédaction. Cela ne les empêche pas d’arborer fièrement une assurance qui enfonce la revue dans une écriture somnolente, pompeuse et « illisible », souvent accusée de prendre trop au sérieux son pouvoir d’exégèse. La nouvelle génération de critique est en place, elle est davantage « critique-critique » ; tous imbibés d’une culture cinéphilique et théorique, ce sont, selon Pierre Kast, des « gloutons optiques ».( Moullet, Douchet, Mourlet…) Les années 70 vont devenir une véritable révolution politique au sein de la revue; passant de droite à gauche voire extrême-gauche, c’est la mode Mao. Les critiques vont se mettre à écrire des textes collectifs, et ne défendrent qu’un cinéma militant… Vis à vis du cinéma étranger : Fréquemment négligé jusqu’au milieu des années 60, à la révélation des « nouveaux cinémas », la critique s’intéresse peu au cinéma étranger, en dehors des Etats-Unis, de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Union Soviétique. Quelques correspondants suffisent à faire échos du reste du monde. La diffusion de ces films reste minoritaire, voire exceptionnelle, une véritable critique ne peut alors se mettre en place. Ce n’est seulement vers 1964 qu’on cherche à faire connaître de manière régulière les cinéastes étrangers. Luc Moullet parle de « tiers-cinéma pour désigner ces films qui échappent aux traditions classiques, au regard cinéphile traditionnel, et dont la vision implique une plongée dans un contexte géographique, social et politique.»
|
|
Parue à Lyon le 1er mai 1952, elle connaît des débuts difficiles mais prometteurs avant de se stabiliser en 1955 à Paris sous la tutelle des éditions de Minuit. Fondée par Bernard CHARDERE, elle fit ses armes sur le modèle de la première édition de La revue du cinéma en s’intéressant particulièrement à l’actualité et l’histoire du cinéma.
Une revue qui souhaite ouvrir le maximum de perspectives afin d’enrichir la connaissance du monde et de l’homme.
|
|
Apparue en janvier 1972, elle disparaît en décembre 1979 pour fusionner avec « La revue du cinéma. » Fondée par les « dissidents » de la revue Cinéma, au moment où les revues ont de moins en moins de lecteurs, ils souhaitent une plus grande indépendance, de la diversification et envisagent le cinéma sous tous ses aspects. Editée par l’Atalante à Paris, elle est dirigée par BEYLIE Claude et MORET Henry. En 86 numéros, ils tentent de reconquérir un lectorat plus exigent, spécialisé et en mal de découverte.
|
Novembre 1954, la Fédération des ciné-clubs décide de remplacer son bulletin « cine-club » par une revue qui dépassera la simple diffusion interne. Dirigée par GUENEE, l’équipe, tout droit sortie des ciné-clubs, est composée de jeunes et d’enseignants donnant ainsi à la revue une approche pédagogique, sérieuse et documentée. Le but est d’actualiser, défendre les mouvements des ciné-clubs et établir un dialogue entre spectateurs et spécialistes. Une revue plus éducative, qui donne plus de renseignements documentés que de véritables avis critiques. Plus ouverte sur le cinéma mondial, elle n’hésite pas à demander à des journalistes étrangers de présenter une cinématographie. La revue n’existe plus depuis peu, disparue en 2000, elle a rejoint le cimetière des éléphants. |
Née en 1946, au moment où l’Etat légitime et soutient enfin le cinéma. Le public souhaite en savoir plus sur ce 7ème art et les ciné-clubs se mettent à publier des bulletins d’informations plus spécialisés. Revue issue de l’UFOLEIS, publiée par la ligue française de l’enseignement. Elle est dirigée par DABERT et CHEVASSU. Jusqu’en 1958, avec ses 12 membres de la rédaction, elle se consacre exclusivement à la vie des ciné-clubs et au côté pratique du film, d’où l’absence de rubrique critique. Elle ne prend pas part aux débats cinéphiliques et politiques des autres revues, éditant des fiches filmographiques à tendances pédagogiques préparées par l’Idhec et des dossiers thématiques pour aider les animateurs de ciné-clubs. Elle a gardé la conception des anciennes revues qui se contentaient de renseigner et non de juger. Elle fusionnera avec La revue du cinéma en 1969, mais dans ses 10 dernières années elle deviendra une revue de cinéma plus diversifiée dans ses choix et ses affirmations. |
Une première tentative née en 1946, mais après 18 numéros, en 1948, elle doit se résigner à disparaître faute d’argent. Elle réapparaît en 1969 en s’associant avec Image et son, éditée par l’UFOLEIS. Elle a pour ambition de réunir des amoureux du cinéma et de les « former » pour l’avenir. A sa tête, CHEVASSU, CORNAND et ZIMMER souhaitent garder la même optique qu’ Image et son mais avec plus de pluralité et refusant toutes discriminations. Dans le numéro 8 (1947), Nino Franck met en avant le travail d’équipe d’une réalisation et entrevoit l’exercice critique en 2 temps : voir puis penser le film. Décembre 1979, l’équipe sera complétée par quelques membres de la revue Ecran obtenant ainsi le plus fort tirage en France, elle finira sa course en octobre 1992 |